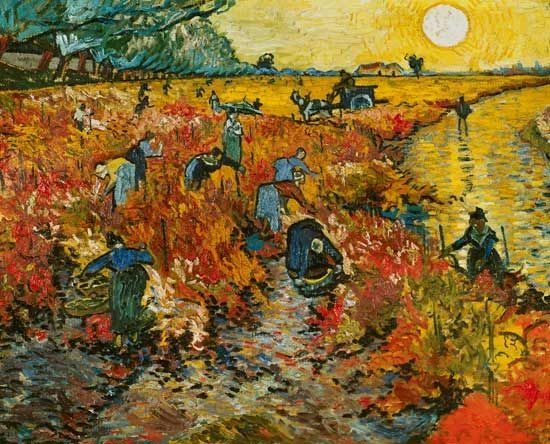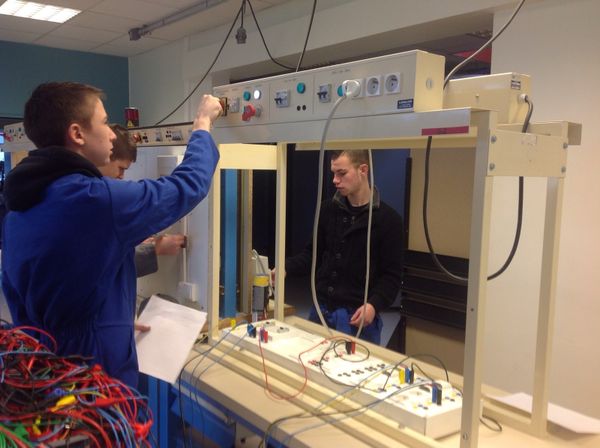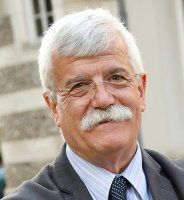« Nous nous engageons ! »
En décembre 2013, dans une « Lettre ouverte aux jeunes de France », les participants au 3ème Forum islamo-chrétien ont proposé qu'ensemble, hommes et femmes de toutes générations et de toutes cultures promeuvent une société de liberté, d'égalité et de fraternité, fondée sur la reconnaissance de la diversité, le respect mutuel et la justice.
Aux jeunes, ils ont lancé cet appel :
À vous, jeunes croyants en Dieu, nous disons : « Ne soyez pas naïfs ! Soyez vigilants ! Dans l'épreuve, restez en accord avec vos valeurs humaines et fidèles à votre foi ! Vous appuyant sur la fidélité de Dieu, soyez artisans de paix ! »
À vous, tous les jeunes, nous disons : « Soyez des citoyens responsables ! Exercez votre liberté de manière active et réfléchie ! Travaillez à tisser des liens dans le respect des valeurs qui fondent notre République. »
Près d'un an plus tard, en regardant les événements de l'année 2014, force est de constater que les foyers de tension et d'absolutisation n'ont cessé de croître et que les chemins pris par les jeunes de France ont été divers.
La paix a fait place à la guerre civile ou aux conflits entre les peuples dans des pays comme ceux de l'Afrique subsaharienne, comme l'Ukraine, la Birmanie, la Libye, Israël et Palestine, l'Irak et la Syrie. Nous venons même d'assister au Proche -Orient à l'entrée en guerre de la France au sein d'une coalition d'une quarantaine de pays.
Le terrorisme et l'instabilité ont progressé dans la zone sahélienne et dans l'Afrique subsaharienne, parfois même « au nom de Dieu » ! Ainsi, en Centrafrique, animosité et haine de l'autre ont remplacé l'entente entre chrétiens et musulmans.
Persécutions, arrestations, viols, exécutions sommaires, telles ont été les exactions commises par l'organisation « Daesh », à l'encontre des civils en Irak et en Syrie parmi les musulmans chiites ou sunnites, les chrétiens, les Yézidis, les Kurdes, les Turcomans, les humanitaires, les journalistes et les reporters. Plus près de nous, en Algérie, le 24 septembre dernier, a été assassiné notre compatriote Hervé Gourdel.
En France même, au regard des événements internationaux et sous l'emprise des clichés médiatiques, des personnes en sont venues à exprimer publiquement le rejet de l'autre. Certains sont même parfois passés à l'acte.
1 Lors de récentes manifestations, on a entendu dans les rues de nos villes cette invective : « Mort aux Juifs ! ». Des églises et des calvaires ont été profanés. Les actes islamophobes se sont multipliés et banalisés. Des tags sont apparus avec cette inscription : « Mort aux Musulmans ! ».
Avec inquiétude, nous observons la montée de l'extrémisme, parfois même violent, chez des jeunes marginalisés, la dérive de quelques centaines de jeunes musulmans de France, présents en Irak et en Syrie aux côtés des terroristes de « Daesh », et le désir d'autres d'aller les rejoindre dans les zones de combat.
Mais tout n'est pas ténèbres. Familles et services de l'Etat ont fini par mesurer la gravité de ces situations. Des actions significatives sont en cours pour interpeller les responsables de ces recrutements et empêcher jeunes filles et garçons de se rendre en ces endroits.
Des jeunes vivent leur citoyenneté de manière constructive, au sein d'associations et de mouvements, par exemple dans le scoutisme, les clubs sportifs ou l'association interreligieuse Coexister ! Ils témoignent de ce que le dialogue et l'interconnaissance sont aujourd'hui, plus que jamais, nécessaires pour désamorcer cette situation explosive qui pousse les gens à vivre dans la peur et la crainte et à trouver refuge dans les options les plus extrêmes.
*
Ce regard sur notre époque et sur la vie de nos contemporains doit nous interroger sur nos propres responsabilités.
Avons-nous été assez vigilants ?
Avons-nous été suffisamment des veilleurs, prêts à dénoncer et à lutter, avec d'autres, contre les injustices de nos sociétés ?
Avons-nous été en capacité à donner aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui du sens à leur vie, au sein de nos traditions religieuses ?
Avons-nous été profondément des croyants libres et engagés, habités du souffle de Dieu, prêts à témoigner de la fraternité des hommes et à agir pour elle, conformément à nos Ecritures ?
Avons-nous été suffisamment des croyants miséricordieux pour aimer le bien et le vouloir sincèrement pour tous les humains, comme nous le demande notre Seigneur ?
Avons-nous suffisamment jeté de ponts entre nos différentes communautés, créé des espaces d'échange et de rencontre, et renforcé la dimension d'entre-connaissance ?
2 Avons-nous vraiment veillé à apaiser les relations entre toutes les composantes de la nation ?
Reconnaissons humblement que les événements actuels ne sont pas que la faute des autres. Par le silence ou l'indifférence des uns, la compromission des autres et les louvoiements en matière de stratégies politiques et d'idéologies religieuses, nous portons une part de responsabilité.
Aujourd'hui, avec force, à travers différents appels et déclarations, les principaux responsables des communautés juives, chrétiennes et musulmanes ont dénoncé les violences à l'égard des minorités et reconnu le droit à tous de pouvoir rester et vivre librement sur leurs terres, dans la dignité et la sécurité, et à pratiquer leur foi.
Mais il nous faut aller plus loin, à savoir nous engager ensemble, juifs, chrétiens et musulmans, là où nous vivons, à œuvrer a u quotidien pour être des artisans de paix et de justice, pour faire reculer l'extrémisme, la persécution et le mépris de l'autre.
Aussi :
• Nous, diacres, évêques, imams, muftis, prédicateurs laïcs, pasteurs, prêtres, rabbins, nous nous engageons à travers nos prédications à promouvoir le respect de l'autre croyant et à inviter nos fidèles à être des citoyens actifs pour contribuer à une société fraternelle et solidaire ;
• Nous, enseignants, formateurs, éducateurs et catéchètes, nous nous engageons à favoriser auprès des enfants et des jeunes l'ouverture, le respect et la connaissance des autres cultures ;
• Nous, responsables d'institutions et de mouvements, nous nous engageons à favoriser l'écoute, le dialogue et le débat franc et respectueux qui conduit à l'estime mutuelle ;
• Nous, écrivains, journalistes, responsables de publication, nous nous engageons à développer dans nos médias une culture de paix et de citoyenneté, et à relayer toute initiative, action ou information invitant à la fraternité humaine ;
• Nous, élus et militants politiques, nous nous engageons à respecter, défendre et promouvoir, concrètement et pour tous, les valeurs qui fondent notre République : Liberté, Egalité, Fraternité ;
• Nous, syndicalistes, ouvriers, artisans et chefs d'entreprise, nous nous engageons à soutenir les projets qui permettent aux jeunes de s'ouvrir aux autres, pour aller au -delà des idées reçues, s'enrichir des différences et trouver leur place dans la société ;
3• Nous, artistes, cinéastes et réalisateurs, nous nous engageons à initier et promouvoir des spectacles musicaux, films et pièces de théâtre qui promeuvent la culture du dialogue, l'écoute de l'autre et l'acceptation des différences ;
• Nous, intellectuels, éditeurs et penseurs, nous nous engageons à encourager toutes les initiatives de rencontres (forum, colloque, débat...), publications et espaces de réflexion qui favorisent le vivre-ensemble et luttent contre toutes les formes de rejet et d'extrémisme ;
• Nous, parents, nous nous engageons à transmettre à nos enfants ces valeurs millénaires que nos textes sacrés nous ont transmis, tel que le pardon, la miséricorde et la fraternité ;
• Nous, militants associatifs de tous horizons, nous nous engageons à développer les activités, loisirs et rencontres susceptibles d'apporter aux jeunes et aux enfants l'équilibre psychologique, spirituel, physique et intellectuel dont ils ont besoin.
Vous qui lisez ce texte, qui veut être une charte à l'engagement concret au quotidien, soyez nombreux à nous rejoindre !
Ainsi, croyants, citoyens, de toutes générations, nous nous engagerons ensemble, dans notre quotidien, à favoriser des attitudes de dialogue et de respect de l'autre pour construire ensemble un monde de paix.
Lyon, place Bellecour, le mercredi 1er octobre 2014
Cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon
Père Eklemandos, Eglise copte orthodoxe
Révérend Ben Harding, Eglise anglicane de Lyon
Père Garabed Harutyunyan, Eglise apostolique arménienne
Monsieur Kamel Kabtane, recteur de la Grande mosquée de Lyon
Père Nicolas Kakavelakis, Eglise orthodoxe grecque de Lyon
Monsieur Joël Rochat, président du Consistoire du Grand Lyon de l'Eglise protestante unie de France Monsieur Richard Wertenschlag, grand rabbin de Lyon
Mgr Jean-Marc Aveline, évêque auxiliaire de Marseille
Ghaleb Bencheikh, président de la Conférence mondiale des religions pour la paix - France
Mhammed Abdou Benmaamar, président de l'Union des musulmans du Rhône
Laïd Abdelkader Bendidi, président du CRCM Rhône-Alpes
Cheikh Khaled Bentounes, chef spirituel de la Fraternité soufie alawiyya
Mgr Yves Boivineau, président de Justice et Paix France
Mgr Jean-Luc Brunin, évêque du Havre
Benaissa Chana, vice-président du CRCM Rhône-Alpes
Mgr Michel Dubost, évêque d'Evry, président du Conseil pour les relations interreligieuses de la Conférence des évêques de France
Mgr François Fonlupt, évêque de Rodez
Anouar Kbibech, président du Rassemblement des Musulmans de France
Amar Lasfar, président de l'Union des Organisations Islamiques de France
Mgr André Marceau, évêque de Nice
Ahmed Miktar, président de l'association imams de France, imam de la mosquée de Villeneuve d'Ascq
Mohammed Moussaoui, président de l'Union des Mosquées de France
Mgr Yves Patenôtre, prélat de la Mission de France, archevêque de Sens-Auxerre
Mgr Marc Stenger, évêque de Troyes, président de Pax Christi France
Christophe Roucou, directeur du Service des relations avec l'islam de la Conférence des évêques de France, Paris
Association Action Espoir
Fédération des Associations des Mosquées de l'Isère (FAMI)
Groupe interreligieux Fils d' Abraham, Lyon
Nacer Abouchi, professeur des universités, Lyon
Myriam Abtroun, sophrologue à Lyon
Youcef Achmaoui, enseignant en sciences islamiques, imam de Garges, journaliste à la chaîne IQRAA,
Val d'Oise
Kaci Ait Yala, directeur général de Continental Edisson
Samir Arbache, professeur de théologie et d'histoire des religions - Faculté de Théologie - Université Catholique de Lille
Kamel Ariouat, responsable de la mosquée ElForqan à Vénissieux
Abdelwahab Bakli, professeur technique et responsable éducatif à Saint Etienne
Xavier de Barbeyrac, diacre, Saint-Marcel-lès-Valence
Salah Bayarassou, responsable de la mosquée Et-Tawba, Lyon 9ème
Jihade Belamri, chef d'entreprise à Lyon
Ahmed Belhay, responsable de la mosquée d'Oullins
Abdelbast Benhissen, imam de la mosquée de Pierre Bénite
Mohamed Bennaji, recteur de la mosquée de Meyzieu
Nora Berra, ancien ministre de la santé
Marc Botzung, prêtre spiritain, Paris
Mohamed Bouabdelli, responsable de la mosquée Erahma de Villeurbanne
Mouhssine Bouayade, chirurgien-dentiste, Saint-Priest
Frère Jean-François Bour, op, délégué diocésain au dialogue inter-religieux, Tours, Indre-et-Loire
Myriam Bouregba, sociologue, formatrice, actrice du dialogue islamo chrétien
Mohamed Bousekri, imam de la mosquée d'Annemasse
Khalid Bouyarmane, imam de la mosquée ElMohsinine "Croix blanche", Bourg-en-Bresse
Fouziya Bouzerda, adjoint au maire de Lyon, chargé du Commerce, de l'artisanat et du
développement économique
Saïd Branine, directeur de la rédaction Oumma.com
Yves Brisciano, diacre, délégué diocésain aux relations avec l'islam, Créteil
Jean Carasso, journaliste, essayiste et éditeur, Vaucluse
Bénédicte du Chaffaut, théologienne, déléguée pour les relations avec les musulmans pour le diocèse de Grenoble-Vienne
Patrice Chocholski, curé-recteur d'Ars, Ars-sur-Formans (Ain)
Wafa Dahmane, journaliste à France 3 et Radio Salam, Lyon
Mustapha Dali, recteur de la mosquée Al Madina Al Mounawara de Cannes
Christian Delorme, prêtre du diocèse de Lyon
Abdallah Dliouah, imam de Valence
Bruno-Marie Duffé, vicaire épiscopal « Famille et Société » et ancien Directeur de l'Institut des Droits de l'Homme de l'Université Catholique de Lyon
Nicole Fabre, pasteur de l'Eglise protestante unie de France, aumônier des hôpitaux
Abdelhamid Fatah, médecin réanimateur à Bourgoin-Jallieu et Lyon sud
Henry Fautrad, prêtre au Mans (Sarthe)
Arnaud Favart, vicaire général de la Mission de France
Vincent Feroldi, déléguée pour les relations avec les musulmans du diocèse de Lyon et co-fondateur du Forum islamo-chrétien
Martine Frénéa, membre du service diocésain du dialogue interreligieux, Clermont-Ferrand
Brigitte Frois, présidente de Keren Or, synagogue libérale de Lyon
Azzedine Gaci, recteur de la mosquée Othmane à Villeurbanne et co-fondateur du Forum islamo-chrétien
Franck Gacogne, prêtre du diocèse de Lyon et curé de Bron
Pierre Guichard, professeur honoraire de l'Université Lyon 2
Marie Jo Guichenuy, déléguée épiscopale pour l'œcuménisme à Lyon
Bruno Abdelhak Guiderdoni, astrophysicien et directeur de l'Institut des Hautes études islamiques
Fawzi Hamdi, recteur de la mosquée Oqba de Vaulx-en-Velin
Ahmed Hamlaoui, recteur de la mosquée de Villefontaine, recteur de la mosquée Dar Essalam de Villefontaine
Sr Colette Hamza, déléguée pour les relations avec les musulmans du diocèse de Marseille
Mosatafa Hassan, responsable de la mosquée de Nantua
Gérard Houzé, groupes œcuménique et interreligieux à Bron
Julienne Jarry, Villeurbanne
Georges Jousse, délégué diocésain aux relations avec l'islam, Bordeaux
Tallele Jrad, enseignant dans un collège de Villefranche sur Saône
Said Kabbouche, directeur de cabinet de la maire de Vaulx-en-Velin
Ali Kismoune, président du club Rhône-Alpes-diversité Abdelhamid Kisrane, recteur de la mosquée de Givors Bernard Lochet, prêtre, vicaire général du diocèse de Clermont-Frrand
Belgacem Louichi, responsable de la mosquée de Bron -Terraillon
Régine Maire, déléguée à l'interreligieux pour le diocèse de Lyon
Karim Menhoudj, imam de la mosquée de Lyon-Gerland
Saliha Mertani, responsable associatif à Vénissieux
Bruno Michaud, délégué de l'évêque de Chambéry pour les relations avec les musulmans
Gaby Moge, déléguée du diocèse d'Annecy pour les relations avec l'islam
Walid Naas, responsable SCI de la mosquée ElForqan à Vénissieux
Hawwa Huê Trinh Nguyên, journaliste à Saphirnews.com, rédactrice en chef de Salamnews
Tareq Oubrou, recteur de la mosquée de Bordeaux
Aldo Oumouden, porte-parole de la Grande mosquée Mohammed VI de Saint Etienne
Djamel Ourak, responsable de la mosquée Essalem, Lyon 3ème
Odile Payen, retraitée, Caluire et Cuire
René Pfertzel, rabbin de la synagogue libérale de Lyon
Emmanuel Pisani, directeur de l'ISTR de Paris
Jeanine et Michel Porte, délégués du diocèse de Moulins pour les relations avec l'islam, Montluçon
Jacques Purpan, prêtre de la Mission de France à Saint- Fons
Danièle Reppelin, membre du conseil diocésain de solidarité du diocèse de Lyon
Joël Satre, délégué diocésain aux relations avec les musulmans à Saint-Etienne
Hafid Sekhri, éducateur, membre du groupe interreligieux Abraham, Lyon 9ème
Mohamed Serbi, responsable de la mosquée de Chambéry
Jane Stranz, pasteur chargée de mission pour les relations œcuméniques de la Fédération protestante de France
Anne Thôni, pasteur de la Fédération protestante de France, présidente de la commission des relations avec l'islam, Paris
Magali Van Reeth, présidente de SIGNIS Europe, Aix en Provence
Anne-Sophie Vivier-Muresan, enseignante à l'Institut Catholique de Paris, Malakoff (Hauts de Seine)
Michel Younès, professeur de théologie et sciences religieuses, Université catholique de Lyon